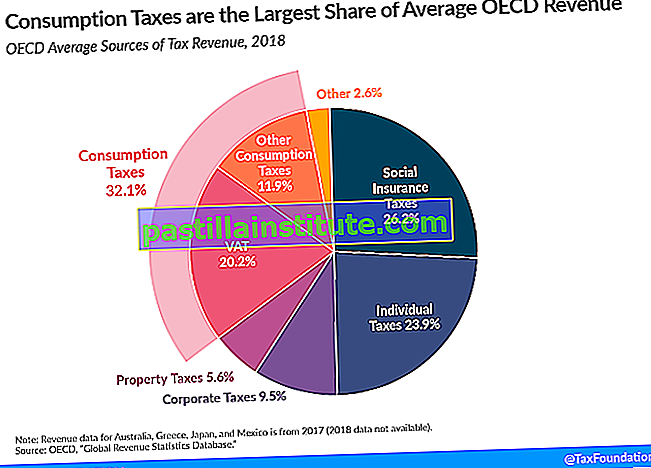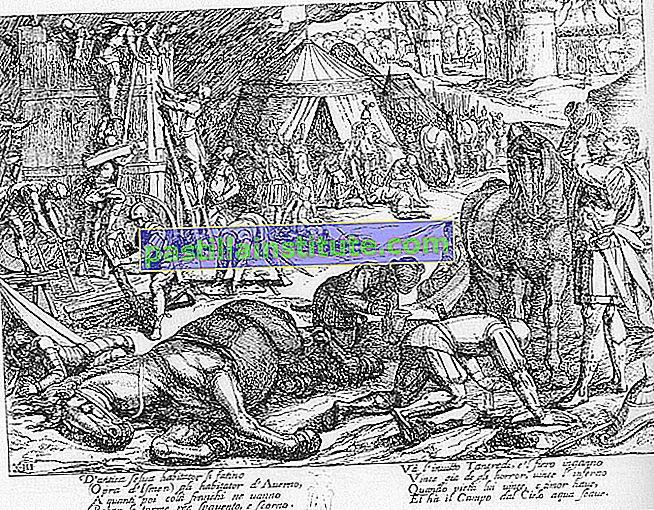Le droit aérien , l'ensemble du droit directement ou indirectement concerné par l'aviation civile. Dans ce contexte, l'aviation s'étend à la fois aux aéronefs plus lourds que l'air et plus légers que l'air. Les véhicules à coussin d'air ne sont pas considérés comme des aéronefs par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), mais la pratique des États individuels à cet égard n'est pas encore réglée. La première législation en matière de droit aérien était un décret de 1784 de la police parisienne interdisant les vols en ballon sans autorisation spéciale.
En raison du caractère essentiellement international de l'aviation, une grande partie du droit aérien relève soit du droit international, soit du droit international uniforme (règles de droit national qui ont été rendues par accord internationalement uniformes). En ce qui concerne le droit aérien international, il n'est guère besoin de mentionner qu'un accord international ou un amendement à celui-ci ne lie que les États qui y sont parties.
Espace aérien
Souveraineté
Un principe fondamental du droit aérien international est que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire, y compris sa mer territoriale. Au tournant du XXe siècle, l'idée que l'espace aérien, comme la haute mer, devrait être libre, était parfois avancée. Mais le principe de la souveraineté de l'espace aérien a été affirmé sans équivoque dans la Convention de Paris sur la réglementation de la navigation aérienne (1919) et par la suite dans divers autres traités multilatéraux. Le principe est réaffirmé dans la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale (1944). L'espace aérien est désormais généralement accepté comme une appartenance au territoire sous-jacent et partage le statut juridique de ce dernier. Ainsi, en vertu de la Convention de Genève sur la haute mer (1958) ainsi que du droit international coutumier,la liberté de la haute mer s'applique aussi bien à la navigation aérienne qu'à la navigation maritime. Verticalement, l'espace aérien se termine là où commence l'espace extra-atmosphérique.
Il découle du principe de la souveraineté de l’espace aérien que chaque État a le droit de réglementer l’entrée d’aéronefs étrangers sur son territoire et que les personnes se trouvant sur son territoire sont soumises à ses lois. Les États autorisent normalement les aéronefs privés étrangers (c'est-à-dire non gouvernementaux et non commerciaux) à visiter ou à traverser leur territoire sans trop de difficultés. De tels aéronefs immatriculés dans des États parties à la Convention de Chicago de 1944 sont, en vertu de la convention, autorisés sur les territoires de tous les autres États contractants sans autorisation diplomatique préalable s'ils ne sont pas engagés dans le transport de passagers, de courrier ou de fret contre rémunération.
Le transport aérien commercial est divisé en services aériens réguliers et vols non réguliers. Les vols charters entrent principalement, mais pas toujours, dans cette dernière catégorie. En vertu de la Convention de Chicago, les États contractants acceptent d'autoriser les aéronefs immatriculés dans les autres États contractants et effectuant des vols commerciaux non programmés à voler sur leur territoire sans autorisation diplomatique préalable et, en outre, à prendre et décharger des passagers, du fret et du courrier, mais en pratique cette disposition est devenue lettre morte.
Pour les services aériens réguliers, le privilège d'exploiter des services commerciaux à travers ou dans un pays étranger a été, au moment de la conférence de Chicago de 1944, divisé en cinq soi-disant libertés de l'air. Le premier est le privilège de traverser un pays sans escale; le second, de traverser avec un arrêt à des fins techniques uniquement. Ces deux libertés sont également appelées droits de transit. Un grand nombre de membres de l'OACI sont parties à l'Accord international de transit des services aériens de 1944, plaçant ces droits sur une base multilatérale. Les autres libertés de l'air sont appelées droits de trafic, se référant aux passagers, au courrier ou au fret transporté sur un service commercial. La troisième des cinq libertés est le privilège de faire entrer et de décharger du trafic à partir de l'État d'origine de l'aéronef ou de la compagnie aérienne;le quatrième est celui de capter le trafic pour l'état d'origine de l'aéronef ou de la compagnie aérienne; le cinquième est celui de la prise en charge ou du déchargement du trafic des Etats tiers sur le territoire de l'Etat accordant le privilège. Cette cinquième liberté est le principal point de négociation dans l'échange des droits de trafic entre les États. Des tentatives ont été faites depuis 1944 pour créer d'autres libertés, mais chaque nouvelle liberté représente généralement en pratique une nouvelle restriction.
Les efforts visant à conclure un accord multilatéral largement acceptable sur les droits de trafic n'ont pas abouti et ces droits ont continué d'être traités dans le cadre d'accords internationaux bilatéraux. Ces accords fixent les routes à desservir, les principes régissant la capacité des services convenus (fréquence du service multipliée par la capacité de charge de l'aéronef utilisé) et les procédures d'approbation des tarifs et des tarifs par les gouvernements respectifs. La plupart des accords exigent que les compagnies aériennes exploitant les mêmes routes se consultent avant de soumettre leurs tarifs aux deux gouvernements concernés pour approbation, et de nombreux accords spécifient l'Association du transport aérien international (IATA), une association de compagnies aériennes, comme organe de ces consultations.Le droit de transporter le trafic intérieur entre des points à l'intérieur d'un État est normalement réservé aux propres compagnies aériennes de cet État. Un accord bilatéral signé aux Bermudes en 1946 entre le Royaume-Uni et les États-Unis a établi un modèle qui a généralement été suivi, bien que l'accord formel de type Bermudes soit probablement accompagné de mémorandums confidentiels fixant diverses restrictions.
Droits privés
Le principe de la souveraineté de l’espace aérien en droit international est probablement bien reflété dans la maxime « Cujus est solum ejus est usque ad coelum et ad inferos » («celui qui possède la terre possède ce qui est au-dessus et en dessous»). En droit privé, l'acceptation de cette maxime ne posa pas longtemps de difficulté, et le Code Napoléon de 1804 l'adopta presque textuellement; plus récemment, cependant, il est plus que discutable qu'un tel principe puisse être accepté sans réserve. Le Code civil allemand (1896) et le Code civil suisse (1907), tout en reconnaissant le principe de Cujus est solum, a adopté une approche fonctionnelle, limitant le droit du propriétaire à une hauteur et à une profondeur nécessaires à sa jouissance du terrain. Dans les pays de common law, les tribunaux sont arrivés à une position globalement similaire. En France aussi, tant la doctrine que les tribunaux ont refusé de prendre Cujus est solum à la lettre. Dans un cas célèbre, Clément Bayard c. Coquerel (1913), la Cour de Compiègne, prêt autorité judiciaire pour la première fois à la théorie de l' abus des droits, dommages - intérêts accordés à un demandeur dont le ballon avait été détruit par des « structures Spite » érigés par le défendeur sur son propre terrain et a ordonné que les pointes incriminées soient abattues.
Au cours des années 1920, il est devenu clair dans la plupart des pays, soit par des décisions judiciaires, soit par une législation expresse, que les aéronefs seraient autorisés à survoler les propriétés privées d'autrui en vol normal conformément à la réglementation aéronautique. Cette immunité ne s’applique qu’au simple passage de l’aéronef et ne s’étend pas aux dommages causés par celui-ci ni aux autres empiétements sur l’utilisation ou la jouissance du sol, tels que les vols trop bas.